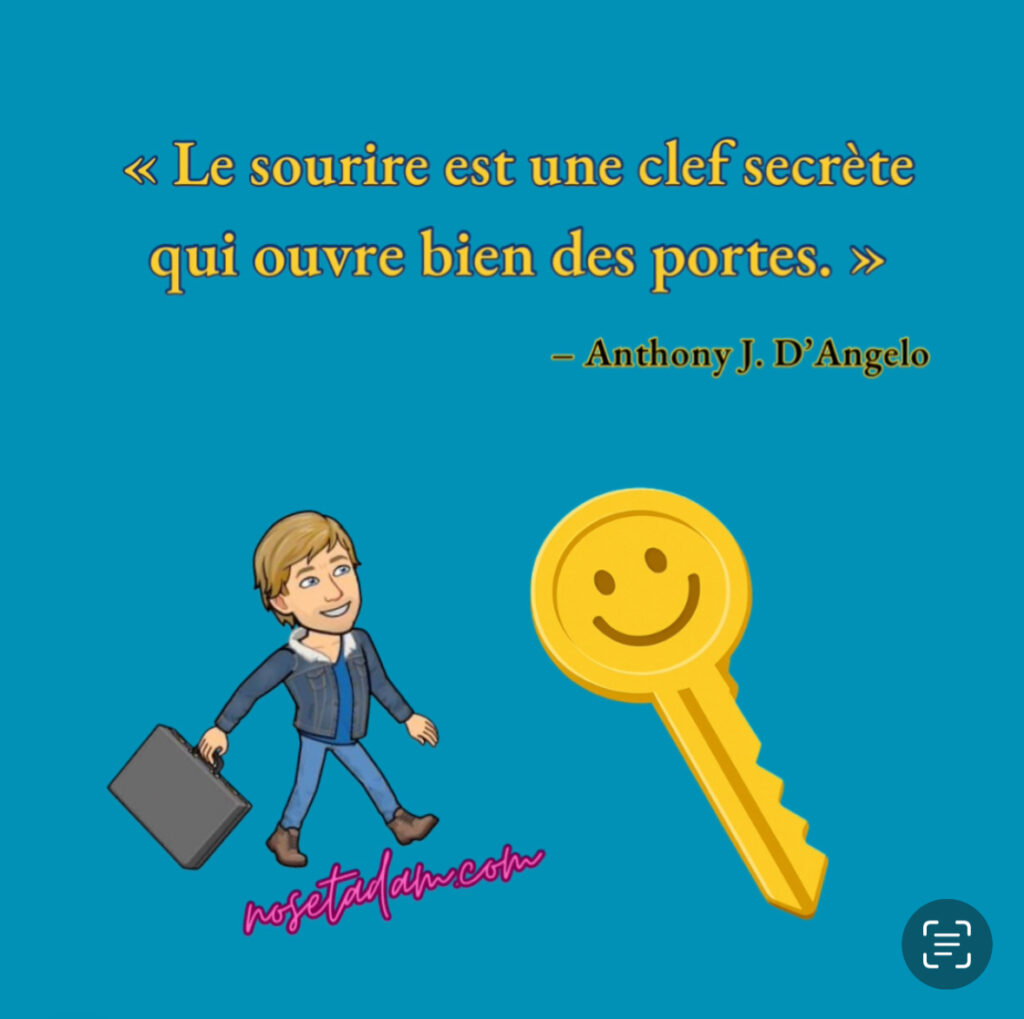
La rentrée a toujours quelque chose de particulier. C’est un mélange subtil d’odeur de cahiers neufs, de cafés du matin, de couloirs qui s’animent, de bureaux qui reprennent vie. C’est aussi cette sensation étrange de se retrouver à la croisée des chemins : d’un côté, le confort rassurant de nos habitudes, de l’autre, l’inconnu des visages que nous allons croiser pour la première fois.
Que nous soyons étudiants sur le point de découvrir une nouvelle classe, ou professionnels prêts à retrouver nos collègues ou à en rencontrer de nouveau, cette période est souvent teintée d’un petit frisson. Celui de l’excitation, mais aussi parfois… d’une certaine appréhension.
Comment allons-nous être perçus ? Allons-nous réussir à créer des liens ? Et si les autres ne s’intéressaient pas à nous ?
La vérité, c’est que nous ne sommes pas les seuls à nous poser ces questions. La plupart des personnes autour de nous ressentent la même chose, même si elles le dissimulent derrière un sourire, un air concentré ou un téléphone compulsivement consulté.
Et c’est justement là que réside notre opportunité : choisir d’aborder les autres avec ouverture, bienveillance et confiance.
Dans cet article, nous allons voir comment transformer cette énergie de rentrée (parfois un peu nerveuse) en une force relationnelle. Nous allons poser ensemble une marche de conduite simple et concrète pour oser aller vers l’autre, créer des échanges sincères et donner à cette nouvelle rentrée un parfum de rencontres authentiques.
Avant de plonger dans les gestes et attitudes qui facilitent le contact, il est essentiel de comprendre pourquoi il n’est pas toujours facile d’aller vers les autres.
Souvent, nous pensons que ce qui nous bloque vient d’eux : leur air fermé, leur manque d’enthousiasme, ou même leur silence. Mais en réalité, une bonne partie de cette difficulté naît en nous. Elle est façonnée par nos pensées, nos expériences passées et par la façon dont notre cerveau réagit à l’inconnu.
En comprenant mieux ces mécanismes, nous pouvons non seulement les apprivoiser, mais aussi apprendre à les transformer en leviers positifs. Alors, regardons ensemble ce qui, parfois, freine notre élan relationnel…
1. Comprendre ce qui freine notre contact.
« Ce que nous pensons des autres en dit souvent plus sur nous que sur eux. »
Aborder quelqu’un semble simple sur le papier : un sourire, un « bonjour », une phrase d’ouverture… Pourtant, dans la réalité, nous avons parfois l’impression qu’une barrière invisible se dresse entre nous et l’autre.
Et cette barrière, bien souvent, nous la portons en nous.
a) Les freins internes.
· La peur du jugement.
Nous craignons de ne pas être à la hauteur, de dire quelque chose de maladroit, de ne pas intéresser l’autre. Cette peur est profondément humaine : notre cerveau est câblé pour rechercher l’acceptation sociale, car elle a longtemps été une question de survie dans l’histoire de l’humanité.
· La comparaison sociale.
Sans même nous en rendre compte, nous passons notre première impression au filtre du « sommes-nous aussi intéressants, compétents ou charismatiques que cette personne ? » Résultat : au lieu de nous concentrer sur la rencontre, nous sommes absorbés par notre propre image.
· Le syndrome de l’imposteur.
Il peut surgir, surtout dans un nouveau groupe : « Et si quelqu’un découvrait que nous ne sommes pas aussi bons que ce que l’on pense ? » Ce doute constant nous pousse parfois à rester en retrait, pour éviter de « nous exposer ».
b) Les biais cognitifs qui amplifient nos peurs.
Notre cerveau aime aller vite pour interpréter ce qui se passe autour de nous. Il utilise des raccourcis mentaux, les biais cognitifs, qui peuvent fausser notre perception :
Biais de négativité : Nous avons tendance à retenir plus facilement les expériences relationnelles désagréables que les réussites. Une mauvaise rencontre passée peut ainsi influencer notre comportement actuel.
Effet projectif : Nous attribuons à l’autre nos propres craintes. Si nous nous sentons mal à l’aise, nous croyons qu’il nous trouve bizarres ou inintéressants… alors que ce n’est souvent pas le cas.
c) Ce que disent les neurosciences.
Les études en neurosciences confirment ce que nous ressentons intuitivement :
Face à l’inconnu, notre amygdale (le centre de gestion de la peur) s’active, envoyant un signal d’alerte.
Cette activation peut provoquer un léger stress, accélérer le cœur, assécher la bouche… bref, des signaux physiques qui nous donnent envie d’éviter le contact.
Mais bonne nouvelle : un simple sourire authentique ou un geste d’accueil bienveillant active la production d’ocytocine (hormone du lien) et de dopamine (hormone du plaisir), ce qui réduit l’anxiété sociale et facilite l’échange.
Antonio Damasio, neurologue et chercheur, explique que nos émotions précèdent souvent nos pensées conscientes : si nous ressentons une menace, notre corps réagit avant même que nous ayons analysé la situation. Cela signifie que, parfois, il faut rassurer notre corps avant même de « raisonner » notre peur.
d) Prendre conscience pour mieux agir.
Reconnaître que ces freins existent n’est pas un signe de faiblesse : c’est un premier pas vers leur dépassement.
Lorsque nous comprenons que l’autre ressent probablement la même tension que nous, cela change notre posture intérieure : nous passons d’une position de défense à une position d’ouverture.
La suite, c’est d’apprendre à transformer cette ouverture en curiosité active… et c’est ce que nous allons voir dans la prochaine étape.
2. Changer notre état d’esprit : de la peur à la curiosité
« Aborder les autres, ce n’est pas se vendre, c’est s’ouvrir. »
Une grande partie de nos blocages relationnels vient de notre manière de voir la rencontre. Si nous l’abordons comme un examen à passer, nous activons automatiquement le stress, la comparaison et l’autocritique. Mais si nous choisissons de la voir comme une exploration, tout change.
a. Passer de « plaire » à « connecter »
Notre erreur la plus fréquente est de croire que nous devons convaincre ou impressionner l’autre. En réalité, la clé d’une première interaction positive n’est pas de plaire à tout prix, mais de créer un lien authentique.
Ne cherchons pas à performer, cherchons à rencontrer. Ce n’est pas un entretien d’embauche permanent : c’est un échange humain.
Lorsque nous retirons la pression de « réussir » notre interaction, nous laissons plus de place à la spontanéité et à la sincérité.
b. L’approche de Carl Rogers : les trois attitudes qui changent tout.
Le psychologue humaniste Carl Rogers a identifié trois attitudes fondamentales qui permettent de créer une relation de confiance :
La congruence –> être soi-même, ne pas jouer un rôle.
Le regard positif inconditionnel –> accueillir l’autre sans jugement préalable.
La compréhension empathique –> chercher à comprendre avant de vouloir répondre.
Ces trois postures ne sont pas des techniques sociales à appliquer mécaniquement. Elles sont un état d’esprit : une manière de se tenir intérieurement pour que l’autre se sente reconnu et respecté.
c. La curiosité comme antidote à la peur
Les neurosciences confirment que la curiosité active des circuits cérébraux qui inhibent la peur sociale. Quand nous nous concentrons sur l’apprentissage ou la découverte de l’autre, notre cerveau déplace son attention de « moi et mon stress » vers « toi et ton histoire ».
C’est ce que Brené Brown appelle « s’exposer à la vulnérabilité » : accepter de ne pas tout maîtriser, mais entrer dans l’échange avec ouverture.
Un bon moyen d’y parvenir est de se poser, juste avant d’aller vers quelqu’un, cette question simple : « Qu’aimerions-nous découvrir chez cette personne ? »
d. Un outil pratique : le recentrage avant interaction
Avant de saluer ou d’engager la conversation :
Inspirons profondément par le nez, expirons lentement par la bouche.
Rappelons-nous notre intention : « nous sommes ici pour rencontrer, pas pour impressionner. »
Sourions légèrement ! Même si nous sommes un peu tendus ! Notre cerveau interprétera ce signal comme un signe de sécurité.
Ces quelques secondes changent notre état interne… et l’énergie que nous dégageons.
Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cet état d’esprit en gestes concrets pour que votre approche soit naturellement accueillante et positive.
3. Les petits gestes qui changent tout.
« On ne se souviendra peut-être pas de tes mots, mais on se souviendra de ton énergie. »
La première impression n’est pas qu’une question d’apparence : elle est avant tout une question d’énergie relationnelle. Et cette énergie se transmet par de petites choses, souvent invisibles, mais profondément ressenties.
a. Le langage du corps avant les mots.
Notre cerveau capte les signaux non verbaux avant même de comprendre le sens des mots. En fait, selon Albert Mehrabian, la communication humaine repose à plus de 90 % sur le non verbal et le paraverbal (ton de la voix, rythme…).
- Sourire réel : pas le sourire forcé de politesse, mais celui qui mobilise aussi les yeux (signe d’authenticité).
- Prendre une posture ouverte : bras décroisés, épaules détendues, orientation du corps vers l’autre.
- Avoir un contact visuel chaleureux : quelques secondes suffisent pour créer un lien, sans « fixer » excessivement.
- Sourire et maintenir un contact visuel activent la libération d’ocytocine, l’hormone du lien, et envoient un signal de sécurité à l’autre.
b. L’art du bonjour
Un simple « bonjour » peut être vide ou porteur d’un vrai accueil.
Utilisons le prénom si nous le connaissons déjà (effet immédiat de personnalisation).
Mettons-y de la présence : regardons la personne, parlons distinctement.
Ajoutons une micro-ouverture : « Bonjour, comment ça va ce matin ? »
Ce n’est pas une formalité : c’est le premier maillon d’une relation.
c. Premières phases : ouvrir la porte, ne pas imposer un discours.
Lors d’un premier contact, privilégions les questions ouvertes qui invitent à l’échange :
« Qu’est-ce qui vous amène ici ? »
« Comment se passe votre rentrée ? »
« Qu’est-ce que vous attendez le plus de cette année, de cette journée ? »
Puis, écoutons activement : hochement de tête, petites reformulations, et pourquoi pas un mot d’encouragement.
d. Le partage pour créer la réciprocité
Les études en psychologie sociale montrent que la réciprocité est l’un des moteurs les plus puissants des liens humains. Partager un petit élément de soi, une anecdote, une impression, invite l’autre à faire de même.
Exemple : « Pour ma part, je trouve que la reprise est toujours un peu intense, mais j’aime bien retrouver cette énergie collective. »
e. Attention à l’effet « trop »
Être avenant ne veut pas dire être envahissant.
Laissons des espaces dans la conversation.
Observons les signaux de confort ou d’inconfort chez l’autre (se détourner, regarder ailleurs, réponses très courtes…).
Si nous ressentons que la personne a besoin d’espace, respectons-la.
Dans la prochaine partie, nous irons plus loin : comment prendre l’initiative relationnelle et créer toi-même les occasions de rencontre, plutôt que d’attendre que les autres viennent vers toi.
4. Oser l’initiative relationnelle : ne pas attendre que ça vienne, mais la créer.
« Ce que tu cherches chez les autres, commence par l’incarner. »
Attendre que quelqu’un fasse le premier pas est une tentation naturelle. Nous nous disons que cela évitera un éventuel rejet, ou que l’autre saura mieux que nous comment amorcer la conversation.
Le problème, c’est que si tout le monde pense ainsi… personne ne bouge.
Prendre l’initiative relationnelle, ce n’est pas être envahissant ou bruyant, c’est simplement oser ouvrir une porte que l’autre pourra choisir de franchir.
a. Rompre la passivité sociale.
Les études en psychologie sociale montrent que dans un nouveau groupe, la majorité des échanges se créent grâce à quelques personnes qui osent amorcer le dialogue.
En osant ce premier pas, nous ne faisons pas seulement du bien à nous-mêmes : nous soulageons aussi ceux qui n’osent pas.
Exemple concret :
- Proposons à une personne seule de se joindre à nous à la pause.
- Lançons un petit groupe d’étude ou de discussion après un cours.
- Invitons un collègue à partager un café ou un déjeuner.
b. Le leadership humain.
Prendre l’initiative n’est pas une question de statut, mais d’attitude.
Ce n’est pas dominer ou diriger, c’est créer des ponts.
C’est montrer que nous sommes capables d’attention, d’inclusion et d’écoute.
Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et du courage relationnel, explique que montrer sa disponibilité émotionnelle est un acte de leadership. Cela envoie un signal implicite : « Ici, on peut se parler. »
c. Utiliser la vulnérabilité comme force.
Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être parfaitement sûr de nous pour aller vers les autres.
Au contraire : dire « Je ne connais pas grand monde ici » ou « C’est ma première rentrée dans cette école » peut créer une connexion immédiate.
Cela montre notre authenticité.
Cela donne à l’autre la permission de se montrer lui aussi plus vrai.
d. Transformer les occasions en habitudes.
L’initiative relationnelle ne doit pas être un coup ponctuel de courage, mais un réflexe.
Chaque semaine, identifie au moins une personne nouvelle à saluer ou avec qui échanger quelques mots.
Répète ce geste, même quand nous sommes fatigués ou occupés : c’est dans la constance que naissent les relations durables.
Dans la prochaine partie, nous verrons que malgré tous nos efforts, il arrive que certaines tentatives n’aboutissent pas… et comment garder le cap quand ce n’est pas réciproque ?
5. Et si ça ne marche pas ? Cultiver la sérénité et la persévérance.
« Nous ne contrôlons pas les autres, mais nous contrôlons notre attitude. »
Même avec les meilleures intentions et les gestes les plus bienveillants, il arrivera que certaines personnes restent fermées, distantes ou peu réceptives. C’est normal.
La clé est de ne pas en faire une affaire personnelle.
Voir mon article : « Les 4 accords toltèques : Un guide vers la liberté personnelle » – Nos états d’Am’s
a. Accepter la diversité des réactions
Les raisons pour lesquelles quelqu’un ne répond pas à notre ouverture peuvent être multiples :
- Timidité ou réserve naturelle
- Fatigue, préoccupations personnelles
- Différences culturelles ou de communication
- Mauvaise expérience passée
La plupart du temps, cela ne nous concerne pas directement.
En stoïcisme, on apprend à distinguer ce qui dépend de nous (nos paroles, nos gestes, notre intention) et ce qui n’en dépend pas (les réactions des autres). Mais je vous en parle souvent.
Si vous n’en avez jamais entendu parler, j’ai cet article pour vous : Comment distinguer ce qui dépend de nous : le guide complet pour reprendre le contrôle de notre vie. – Nos états d’Am’s
b. Garder la porte ouverte.
Même si un premier contact ne donne rien, rien ne nous empêche :
- De rester cordial et disponible.
- De continuer à saluer, même brièvement.
- D’éviter de basculer dans l’indifférence ou le ressentiment.
- De laisse le temps faire son travail : parfois, la confiance met des semaines à s’installer.
c. Protéger son énergie.
Ouvrir la porte aux autres ne veut pas dire s’épuiser à vouloir convaincre tout le monde.
Investissons notre énergie dans des relations réciproques et nourrissantes.
Acceptons que certaines connexions ne se fassent pas, et que ce soit parfaitement sain.
d. Transformer l’expérience en apprentissage.
Chaque tentative, même infructueuse, nous entraîne à améliorer notre aisance relationnelle.
- Observons ce qui a fonctionné ou non.
- Ajustons notre approche selon le contexte et la personne.
En fin de compte, ce qui compte n’est pas que chaque rencontre soit un succès, mais que nous continuons à incarner la personne que nous voulons être dans nos relations.
Conclusion : cette rentrée est comme une opportunité de tisser du lien.
Chaque rentrée est un chapitre neuf, une page blanche que nous pouvons choisir de remplir avec des gestes simples, mais puissants.
Aborder positivement les autres, ce n’est pas seulement sourire ou dire bonjour : c’est un état d’esprit. C’est décider de créer plutôt que d’attendre, d’ouvrir plutôt que de se refermer, d’offrir une écoute sincère plutôt que de se réfugier dans l’indifférence.
Souvenez-vous :
Vous ne contrôlez pas l’accueil que vous recevrez, mais vous avez toujours le pouvoir de planter des graines de bienveillance.
Chaque mot chaleureux, chaque attention discrète, chaque sourire est un investissement dans le climat humain autour de vous.
Les relations solides se construisent par accumulation de petits gestes quotidiens.
Alors, en cette rentrée, osons faire ce petit pas vers l’autre.
Osons tendre la main, poser une question, échanger un mot.
Peut-être qu’aujourd’hui, ce sera juste une conversation anodine… ou peut-être le début d’une amitié, d’une collaboration, d’un soutien précieux dans les mois à venir.
Et si tout le monde décidait, à son niveau, de faire ce premier pas ?
Nous découvririons que la rentrée n’est pas seulement un retour au travail ou aux études, mais un véritable retour à l’humain. Et ça, c’est sans doute ce dont le monde a le plus besoin !
À très vite pour la suite.