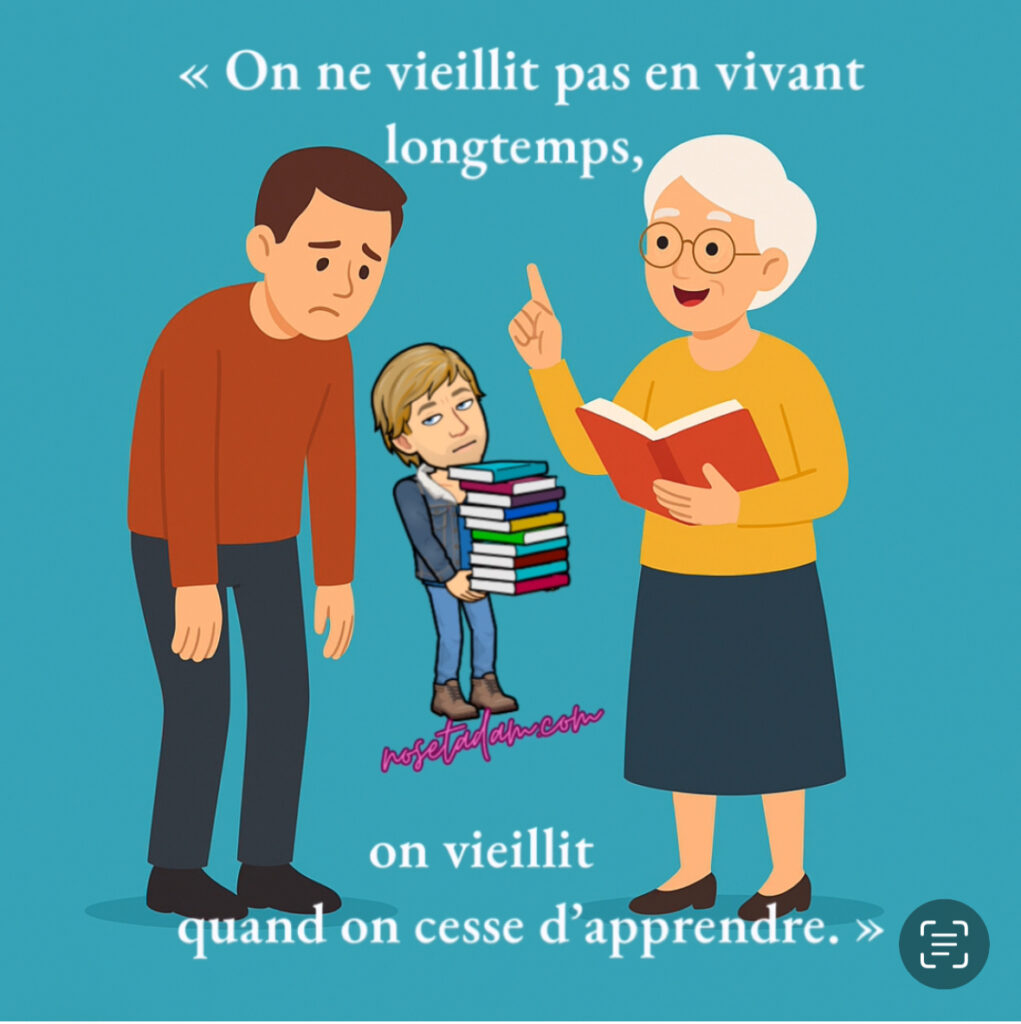
Quand j’ai décidé d’entreprendre la formation de coach, plus de trente ans après avoir quitté l’école normale, j’ai ressenti une véritable appréhension. Une petite voix me soufflait : « Ton cerveau a vieilli, comment vas-tu faire pour retenir toute cette nouvelle matière ? Tu as toujours eu du mal à apprendre par cœur, alors trente ans après ! Des neurosciences ! Des principes de psychologie… » J’avais très peur que cette faiblesse me bloque.
En plus, j’avais mon travail d’enseignant et il n’était pas question de passer les nuits à étudier comme à l’époque de mes études supérieures. Je savais donc que je devais trouver une autre approche : apprendre à apprendre. Alors, j’ai cherché des solutions, testé des méthodes, parfois avec succès, parfois avec frustration. Petit à petit, j’ai découvert que notre mémoire n’est pas une fatalité figée qui s’éteint avec le temps. Elle fonctionne comme un muscle : plus on la sollicite intelligemment, plus elle se renforce.
Ce que j’ai compris, c’est qu’il n’existe pas de recette miracle. C’est un processus, comme la musculation : répétition après répétition, effort après effort, les progrès apparaissent. Cela demande du temps, de la patience, mais le plus important, c’est que c’est possible.
Dans cet article, je vais partager avec vous les techniques que j’ai apprises, expérimentées et validées sur le terrain. Pas de promesses magiques, mais des stratégies concrètes, efficaces, et applicables dès aujourd’hui.
Alors, prêts à vous muscler le cerveau et à transformer votre mémoire en véritable alliée ?
1. Comprendre comment le cerveau apprend.
Avant de chercher à retenir plus vite, il est utile de savoir comment notre cerveau s’y prend pour apprendre. Ce n’est pas de la théorie inutile : comprendre le mécanisme permet de l’utiliser à notre avantage.
Il existe un trio gagnant : attention, encodage, consolidation
Quand nous découvrons une information, notre cerveau passe par trois étapes clés :
L’attention : sans elle, rien ne passe. C’est comme vouloir remplir un verre… sans ouvrir la bouteille. Les neurosciences montrent que notre mémoire de travail (cette petite « boîte » où l’on garde temporairement l’information) est limitée à quelques éléments à la fois. Autrement dit, si nous apprenons distraits ou en multitâche, nous perdons une grande partie des données avant même qu’elles ne soient enregistrées.
L’encodage : une fois l’attention captée, l’information doit être transformée en signal durable. C’est ici que l’hippocampe joue son rôle de chef d’orchestre, reliant la nouvelle donnée aux connaissances déjà présentes. Plus nous faisons de liens, plus l’encodage est solide.
La consolidation : ce processus se déroule principalement pendant le sommeil. Les chercheurs de Harvard ont démontré que réviser juste avant de dormir peut aider à renforcer la mémorisation, car le cerveau « rejoue » nos apprentissages durant la nuit.
Pourquoi oublions-nous ? (Et pourquoi est-ce une opportunité ?)
L’oubli n’est pas une faiblesse, mais une fonction naturelle. Le psychologue Hermann Ebbinghaus a montré dès le XIXe siècle que nous perdons en moyenne 60 % d’une nouvelle information dans les 24 heures… si nous ne la retravaillons pas.
Cela peut sembler décourageant, mais c’est une chance : le cerveau trie, filtre et garde ce qui est jugé pertinent. En réactivant volontairement une donnée, nous lui envoyons le message : « Ceci est important, conserve-le ! »
Le rôle de l’émotion et de la motivation
Une chanson entendue à 15 ans reste gravée à vie… mais une formule de maths apprise par cœur s’évapore souvent avant l’examen. Pourquoi ? Parce que l’émotion active le système dopaminergique, qui facilite l’ancrage dans la mémoire. En clair : plus nous apprenons avec curiosité, plaisir ou utilité perçue, plus notre cerveau se mobilise.
Mémoire de travail, mémoire à long terme et plasticité : les coulisses de l’apprentissage.
La mémoire de travail : le bureau provisoire.
Imaginez votre mémoire de travail comme un petit bureau. Nous pouvons y poser quelques feuilles (idées, infos, chiffres), mais si nous en empilons trop, ça déborde et les feuilles tombent par terre.
Les neurosciences estiment que nous pouvons maintenir environ 7 éléments en mémoire de travail (Miller, 1956) et parfois moins si nous sommes fatigués ou distraits.
De plus, apprendre dans le bruit, en répondant aux messages ou en zappant d’une tâche à l’autre, c’est condamner notre bureau à être envahi de parasites et de papiers éparpillés.
La mémoire à long terme : la bibliothèque intérieure.
Contrairement à ce petit bureau, la mémoire à long terme est immense : une gigantesque bibliothèque où nous stockons nos souvenirs, nos savoirs, nos gestes, nos habitudes.
Mais pour que l’information passe du bureau provisoire (mémoire de travail) à la bibliothèque (mémoire à long terme), il faut :
- répéter (les fameuses révisions espacées),
- lier la nouvelle donnée à quelque chose que nous connaissons déjà,
- donner du sens (une info isolée s’oublie, une info reliée s’ancre).
La plasticité neuronale : le secret de notre cerveau
Bonne nouvelle : notre cerveau n’est pas figé. Il se reconfigure sans cesse grâce à la plasticité neuronale. Chaque fois que nous apprenons, de nouvelles connexions se créent entre les neurones. Plus nous répétons, plus ces connexions deviennent solides, comme un chemin de forêt qui se transforme en autoroute à force de passages. C’est la neuroplasticité du cerveau et cela veut donc dire que même si nous avons l’impression d’avoir une « mauvaise mémoire », nous pouvons tous l’entraîner. Le cerveau est comme un muscle : il se renforce à l’usage.
2. Les erreurs classiques qui nous font perdre du temps
On croit souvent « travailler dur » alors qu’on travaille surtout mal. Notre cerveau a ses propres règles du jeu, et si nous les ignorons, nous gaspillons une énergie précieuse.
Pour vous faciliter la tâche, voici les pièges les plus fréquents qui nous empêchent de progresser.
Erreur n° 1 : relire sans fin ses notes.
Qui n’a jamais surligné un cours entier en se disant : « Comme ça, au moins, je retiendrai » ? Malheureusement, les neurosciences sont claires : la relecture passive est l’une des méthodes les moins efficaces pour mémoriser.
Pourquoi ? Parce qu’elle donne une illusion de maîtrise. On reconnaît l’information en la voyant, mais on est incapable de la rappeler sans support.
Ce qui marche mieux : le rappel actif (active recall). Fermer son cahier et se poser la question soi-même. Oui, c’est plus inconfortable… mais bien plus efficace.
Erreur n° 2 : apprendre en mode « cramming ».
Réviser la veille d’un examen jusqu’à 2 h du matin ? Classique. Et complètement contre-productif.
La fameuse courbe de l’oubli d’Ebbinghaus montre que nous perdons très vite ce que nous avons appris en une seule session compacte. Le cerveau, saturé, rejette une grande partie des infos.
Ce qui marche mieux : la répétition espacée. Revoir plusieurs fois à intervalles réguliers (par ex. après 1 jour, 3 jours, 1 semaine). C’est le principe derrière les applis de flashcards comme Anki.
Erreur n° 3 : le multitâche.
Apprendre en jetant un œil à ses notifications ou à la télé ? C’est comme vouloir remplir une bouteille trouée.
Les neurosciences ont montré que le cerveau ne fait pas deux tâches complexes en même temps : il switch rapidement d’une activité à l’autre, perdant à chaque fois du temps et de la concentration. Avec comme seul résultat un apprentissage plus lent et une mémoire plus fragile.
Ce qui marche mieux : le monotâche. 25 minutes de concentration totale (technique Pomodoro), puis une vraie pause. je vous en parle dans quelques lignes
Erreur n° 4 : négliger le sommeil et le repos
Certains pensent gagner du temps en sacrifiant leur nuit. C’est oublier que la consolidation de la mémoire se fait surtout pendant le sommeil profond.
Des chercheurs de Harvard ont montré que réviser avant de se coucher améliore la rétention, car le cerveau « rejoue » littéralement les apprentissages durant la nuit.
Ce qui marche mieux : dormir suffisamment (7-8h) et placer des mini-siestes, 25 minutes suffisent, après un apprentissage intensif si possible.
Erreur n° 5 : vouloir tout retenir
Notre mémoire n’est pas faite pour tout stocker. Elle trie et hiérarchise. Vouloir tout apprendre par cœur, sans distinguer l’essentiel, c’est s’épuiser pour rien.
Ce qui marche le mieux c’est d’utiliser la loi de Pareto (80/20). Identifier les 20 % d’informations qui apportent 80 % des résultats, et concentrer nos efforts dessus.
La plupart des erreurs que nous venons de voir viennent d’une vision « quantitative » de l’apprentissage (plus d’heures = plus de résultats).
En réalité, c’est la qualité de la méthode qui fait toute la différence.
3. Les leviers pour apprendre plus vite
Heureusement, notre mémoire n’est pas condamnée à fuir comme l’eau entre les doigts. Les chercheurs en neurosciences et en psychologie cognitive ont identifié des leviers puissants qui permettent d’apprendre plus vite et de retenir plus longtemps. Bonne nouvelle : ces techniques sont simples à mettre en place.
a) La répétition espacée ou comment dompter la courbe de l’oubli.
Souviens-toi d’Ebbinghaus : sans réactivation, nous désapprenons vite. Mais si nous révisons à des intervalles réguliers (1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois), le cerveau comprend : « Cette info est importante, je dois la stocker durablement ».
C’est comme arroser une plante régulièrement plutôt que de la noyer d’un coup.
De nombreuses applis comme Anki ou Quizlet utilisent déjà cet algorithme.
b) Le rappel actif (active recall) comment se tester plutôt que relire.
Relire, on l’a vu, c’est une illusion. Ce qui marche vraiment, c’est fermer notre cahier et se poser des questions :
« Quels sont les trois points clés que je viens d’apprendre ? »
« Comment expliquerais-je ce concept à un ami ? »
Cette stratégie met notre mémoire à l’épreuve et renforce le chemin neuronal, un peu comme muscler une jambe en courant plutôt qu’en lisant un guide de sport.
c) L’association d’idées et les images mentales
Notre cerveau adore les histoires, les images et les métaphores.
Par exemple, pour retenir que l’hippocampe est la région clé de la mémoire, imagine un petit cheval de mer (car « hippocampe » vient du grec « cheval de mer ») qui classe nos souvenirs dans une bibliothèque. Plus la vision est vivante, drôle ou étrange, plus elle s’ancre dans notre mémoire.
d) L’émotion et la curiosité : le carburant de l’apprentissage
Un souvenir lié à une émotion forte (un premier baiser, une victoire, une peur) reste gravé à vie. Pourquoi ? Parce que la dopamine et l’adrénaline activent l’hippocampe et intensifient la consolidation. C’est à nous d’apprendre à rendre l’info intéressante pour nous. Cherchons un lien avec nos passions, nos projets, notre quotidien. Plus c’est utile ou amusant, plus ça s’ancre.
e) L’effet Feynman : enseigner pour apprendre
Le physicien Richard Feynman avait une méthode simple, il expliquait un concept complexe avec des mots simples, comme s’il le racontait à un enfant. Quand nous parvenons à expliquer clairement un concept, c’est que nous l’avons compris et intégré. Sinon, nous allons vite identifier les zones floues à retravailler.
Pour apprendre vite, il faut répéter intelligemment, rappeler activement, créer des liens vivants et injecter de l’émotion dans nos apprentissages.
4. Les boosters naturels de la mémoire
Notre cerveau n’apprend pas dans le vide. Il est influencé par notre corps, notre environnement et nos habitudes quotidiennes. Avant de chercher des méthodes sophistiquées, il est utile de s’appuyer sur ces piliers de base, trop souvent négligés.
Le sommeil est notre allié numéro un.
De nombreuses études en neurosciences l’ont confirmé : c’est pendant le sommeil que notre mémoire se consolide. L’hippocampe « rejoue » littéralement les apprentissages de la journée et les transfère vers la mémoire à long terme.
Une nuit blanche peut réduire de moitié nos capacités de mémorisation.
Astuce : réviser juste avant de dormir, ou faire une courte sieste après un apprentissage intensif, améliore significativement la rétention.
L’exercice physique est comme le carburant des neurones
Bouger, ce n’est pas seulement bon pour le corps : c’est aussi un booster pour le cerveau.
L’activité physique augmente l’oxygénation et favorise la libération de BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), une protéine qui soutient la plasticité neuronale. En clair : le sport aide à créer de nouvelles connexions cérébrales. Ce qui est magnifique c’est que nous n’avons sas besoin d’un marathon : 20 à 30 minutes de marche rapide ou de vélo suffisent déjà à améliorer la concentration et la mémoire.
L’alimentation ou comment nourrir son cerveau intelligemment.
Le cerveau représente seulement 2 % du poids du corps, mais consomme environ 20 % de notre énergie. Sa performance dépend donc directement de ce que nous mangeons.
- Les oméga-3 (poissons gras, noix) favorisent la communication entre neurones.
- Les antioxydants (fruits rouges, légumes verts) protègent le cerveau du stress oxydatif.
- L’hydratation : une déshydratation légère (–2 % d’eau) suffit à réduire la mémoire et l’attention.
Il n’y a qu’une seule règle simple à retenir, un cerveau qui carbure, c’est un cerveau bien nourri et bien hydraté.
La gestion du stress : apprendre à calmer le brouillard mental.
Un peu de stress peut stimuler l’attention, mais trop de cortisol (l’hormone du stress) brouille les circuits de la mémoire. Sous pression chronique, l’hippocampe s’épuise et notre capacité à mémoriser s’effondre.
Heureusement, il existe des solutions simples : la respiration profonde, la cohérence cardiaque, ma méditation, les pauses régulières. Je vous en parle pratiquement dans chaque article, même 5 minutes suffisent pour réduire la tension et libérer de l’espace mental.
Finalement, apprendre plus vite et retenir plus longtemps n’est pas seulement une question de méthode. C’est aussi une question de sommeil réparateur, activité physique régulière, alimentation équilibrée et gestion du stress. Un cerveau bien entretenu, c’est une mémoire qui performe naturellement.
5. Les stratégies pratiques et rapides pour apprendre efficacement.
Apprendre plus vite ne nécessite pas forcément des heures supplémentaires ou des techniques compliquées. Avec quelques stratégies simples et régulières, nous pouvons booster notre mémoire et transformer nos habitudes d’apprentissage.
La technique Pomodoro.
Voici une méthode testée et approuvée de découpes en petites sessions.
Notre attention est limitée : après 25-30 minutes de concentration, elle chute.
La technique Pomodoro consiste à :
- Travailler intensément pendant 25 minutes.
- Faire une pause de 5 minutes.
- Et recommencer.
- Après 4 cycles, prendre une pause plus longue (15-20 minutes).
Cette méthode à l’avantage de rendre l’apprentissage plus structuré, diminuer la fatigue mentale et la mémoire retient mieux les informations. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, je vous mets un lien vers un de mes produits gratuits : Abondance – Nos états d’Am’s
La règle des 80/20 : se concentrer sur l’essentiel.
Le principe de Pareto s’applique aussi à l’apprentissage : 20 % des informations produisent 80 % des résultats. Il est donc important d’identifier ce qui nous est vraiment utile ou prioritaire et concentrer nos efforts dessus, plutôt que d’essayer de tout retenir.
Expliquer ce que l’on apprend : effet Feynman.
Pour vérifier que nous avons véritablement compris quelque chose, rien de mieux que de l’expliquer à quelqu’un d’autre, ou même à voix haute pour soi. Si nous butons sur certaines explications, c’est exactement là qu’il faut retravailler l’information.
Cette méthode permet de transformer un savoir passif en connaissance active.
Créer des cartes mentales ou des schémas.
Visualiser les informations permet de créer des liens et d’ancrer les connaissances plus solidement. Les concepts clés deviennent des branches. Les exemples et détails, des sous-branches. Les couleurs, dessins ou symboles renforcent la mémoire visuelle.
La carte mentale est idéale pour réviser rapidement avant un examen ou un projet important.
Répéter dans différents contextes.
Apprendre une information dans un seul contexte limite la capacité à la rappeler ailleurs.
Lire un concept dans son bureau, le revoir dans le salon, puis l’expliquer à un ami avant de l’expliciter dans une réunion.
Cette variation de contexte renforce la flexibilité de la mémoire et l’ancrage à long terme.
Associer l’apprentissage à une émotion ou un geste.
Notre cerveau retient mieux ce qui est associé à une émotion, même légère, ou à un geste répétitif. Si nous sourions en répétant une notion, ou si nous créions une petite histoire autour d’un concept, les informations deviennent plus vivantes et faciles à rappeler.
Utiliser des supports variés : lecture, audio, vidéo.
Le cerveau adore la diversité : lire un texte, écouter un podcast et regarder une vidéo sur le même sujet permet de renforcer l’apprentissage par multicanal. Plus l’information est traitée sous différentes formes, plus elle s’ancre dans notre mémoire.
Que retenir de ces stratégies simples : Pomodoro, 80/20, Feynman, cartes mentales, répétitions variées autorisent de métamorphoser chaque session d’apprentissage en un moment efficace et durable. L’important n’est pas la quantité d’heures, mais la qualité des techniques utilisées.
6. Comment retenir sur le long terme ?
Apprendre vite, c’est bien. Mais retenir durablement, c’est mieux. La mémoire fonctionne par répétition, utilisation et association. Voici comment transformer des connaissances temporaires en souvenirs solides et exploitables.
Planifier des révisions régulières.
La répétition espacée, déjà évoquée, reste la méthode la plus efficace.
Créer un calendrier de révision : revoir les données après 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois…
Les neurosciences montrent que chaque réactivation renforce les connexions neuronales, comme un chemin de forêt qui devient une autoroute.
Appliquer immédiatement ce que nous apprenons.
Une information utilisée concrètement est mémorisée plus longtemps.
Exemple : si vous apprenez une nouvelle méthode de gestion du temps, testez-la le jour même.
Transformer le savoir en action, c’est ancrer le souvenir dans l’expérience, pas seulement dans la théorie.
Varier les contextes
Étudier dans différents lieux à différents moments et sous différentes formes aide le cerveau à stocker les informations de façon flexible.
Exemple : lire, écrire, écouter, expliquer à quelqu’un d’autre.
Plus l’information est « rencontrée » de manière diversifiée, plus elle devient récupérable facilement dans n’importe quelle situation.
Associer le savoir à des émotions ou des histoires.
L’émotion active la dopamine, qui renforce la mémorisation.
Exemple : créer une anecdote ou une image mentale autour d’un concept difficile.
Résultat : l’information devient vivante, facile à rappeler et agréable à apprendre.
Créer un système de rappel.
Utiliser des alertes, des cartes mémoire, des résumés ou un journal de révisions.
L’important est de revenir régulièrement sur l’information pour empêcher l’oubli naturel.
Faire le lien avec ce que l’on connaît déjà.
Le cerveau retient mieux une nouvelle information lorsqu’elle s’intègre à un réseau existant.
Exemple : relier un concept abstrait à une expérience personnelle ou à une autre connaissance.
Chaque lien renforce la structure globale de la mémoire.
En résumé : Retenir sur le long terme, c’est combiner révision régulière, application pratique, variété des contextes, émotions, rappels et liens avec les connaissances existantes.
Avec ces clés, chaque apprentissage a toutes les chances de rester disponible lorsque vous en aurez vraiment besoin.
Conclusion : Transformer notre mémoire en alliée
Quand j’ai entrepris la formation de coach, j’avais peur que mon cerveau soit à mon âge complètement incapable de retenir de nouveaux concepts. Mais cette expérience inconfortable m’a appris une chose essentielle : la mémoire n’est pas un privilège réservé à quelques-uns, c’est un potentiel que nous possédons tous. La science nous montre aujourd’hui que notre cerveau est plastique, malléable, capable de se réorganiser et de se renforcer à tout âge. Et ça, c’est une découverte magnifique qui rend tout possible.
Bien sûr, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Comme pour la musculation, les progrès viennent avec la régularité : séance après séance, révision après révision, notre mémoire s’entraîne, se construit, se transforme. Oublier fait partie du processus, mais réactiver, tester, associer et répéter permettent de la consolider durablement.
Les techniques que nous avons vues, répétition espacée, rappel actif, cartes mentales, effet Feynman, Pomodoro ne sont pas des gadgets. Elles sont les haltères, les poids, les exercices qui font grandir notre cerveau.
À cela s’ajoutent les piliers invisibles, mais essentiels : le sommeil, le sport, la nutrition, la gestion du stress.
Alors, plutôt que de voir notre mémoire comme une passoire capricieuse, apprenons à la traiter comme une alliée fidèle. Concentrons-nous sur l’essentiel, avançons pas à pas, et souvenons-nous que chaque effort compte. Car investir dans notre mémoire, c’est investir dans notre liberté d’apprendre, de comprendre, et d’agir et de changer.
La bonne nouvelle ? C’est possible, quel que soit notre point de départ. Un pas à la fois, petit à petit pour ne pas provoquer l’indigestion !
J’en suis la preuve vivante : si mon cerveau a pu ingurgiter toute cette matière après trente ans d’arrêt, le vôtre le peut aussi.
Alors, prêts à remuscler le vôtre et à écrire la suite de votre histoire d’apprentissage ?
C’est possible et nous pouvons faire ce chemin ensemble ! Si vous êtes prêt, je suis là pour vous accompagner aussi sur ce chemin.
À très vite pour la suite
Vous pouvez lire aussi : 3 livres essentiels pour apprendre à mieux gérer son temps (Et une routine simple à mettre en place) – Nos états d’Am’s
Merci Fred très intéressant
Merci beaucoup Jenny, ça me fait très plaisir que tu sois venue lire un de mes articles et surtout qu’il te parle… il ne reste plus qu’à tester ce qui te convient à toi en particulier ! Suis curieux de lire ton retour🧐. À très vite 😍