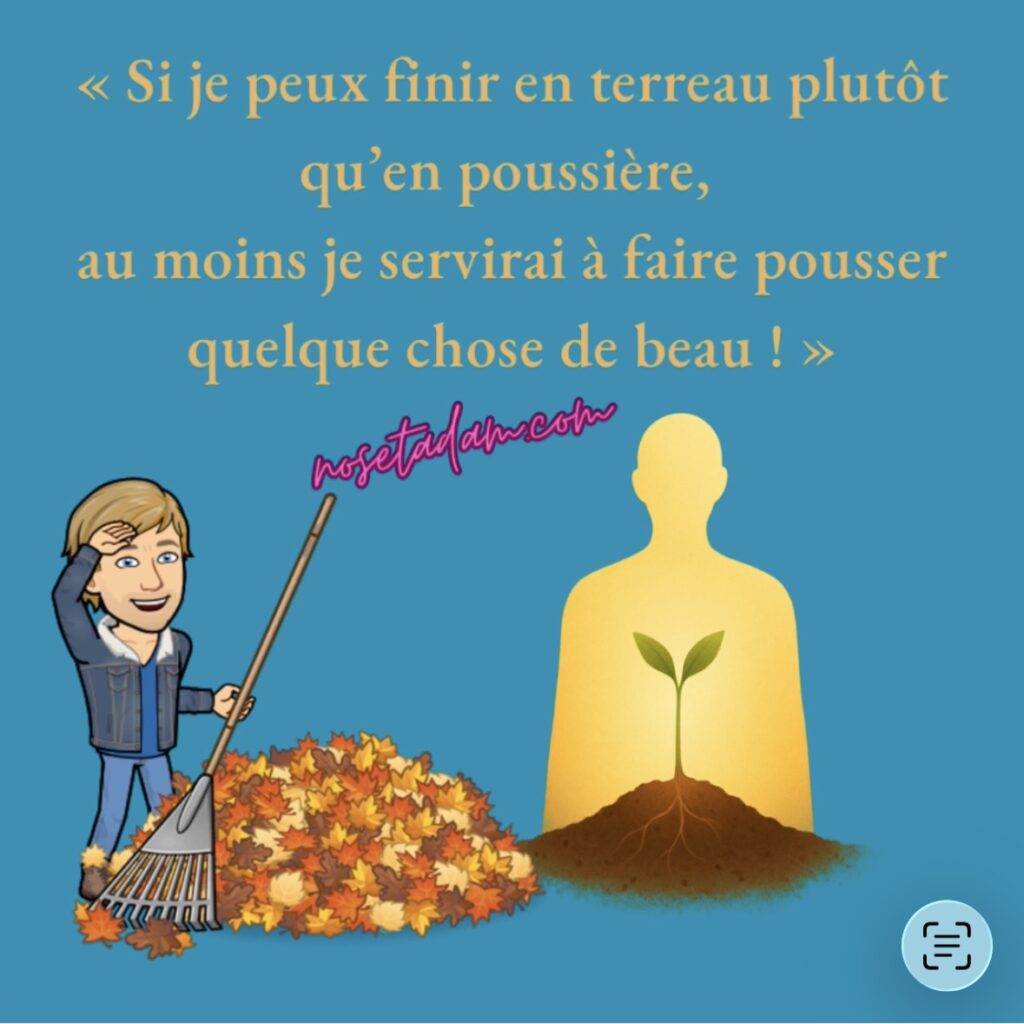
Chaque année, au moment de la Toussaint, nous honorons nos défunts, nous fleurissons leurs tombes et nous repensons à ceux qui nous ont quittés. Mais une question demeure rarement posée : que devient réellement notre corps après la mort ?
Enterrement, crémation… depuis des siècles, nous suivons des rites immuables, portés par la tradition, la religion ou la culture. Pourtant, aujourd’hui, une nouvelle alternative apparait, surprenante pour certains, révolutionnaire pour d’autres : le compostage humain.
Également appelé humusation ou recomposition humaine, ce procédé consiste à transformer naturellement le corps en humus fertile, capable de nourrir la Terre. Une idée qui peut sembler dérangeante au premier abord, mais qui séduit de plus en plus de personnes soucieuses de leur impact écologique jusque dans leur dernier souffle.
Alors, devons-nous considérer cette pratique comme une lubie farfelue de militants écologistes ? Ou au contraire comme l’ultime acte de générosité, un geste par lequel nous rendons à la nature ce qu’elle nous a prêté toute notre vie ?
Dans cet article, nous allons explorer ce qu’est réellement le compostage humain, ses avantages, son statut légal en Belgique et ailleurs, les débats qu’il suscite, et même ce qu’en auraient pensé les philosophes stoïciens. Une réflexion à la croisée de l’écologie, de l’éthique et de notre rapport à la mort.
1. Qu’est-ce que le compostage humain ?
Le compostage humain, également appelé humusation ou recomposition humaine, est un procédé funéraire qui vise à transformer naturellement le corps d’une personne décédée en humus fertile. Plutôt que d’enterrer le corps dans un cercueil traditionnel ou de le réduire en cendres par crémation, cette méthode propose un retour à la terre au sens littéral.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Concrètement, le corps est placé dans un caisson ou un cercueil spécialement conçu, entouré de matières organiques comme des copeaux de bois, de la paille et parfois des micro-organismes qui favorisent la décomposition.
- Étape 1 : le corps repose dans un environnement contrôlé, à température et humidité optimales.
- Étape 2 : les bactéries et micro-organismes décomposent progressivement les tissus et les os.
- Étape 3 : en 12 à 18 mois, le processus aboutit à un humus riche et sain, stérile de tout agent pathogène, pouvant servir à fertiliser le sol.
Ce processus s’inspire directement de ce que la nature fait déjà, mais dans des conditions accélérées et maîtrisées.
En quoi est-ce différent d’un enterrement ou d’une crémation ?
Dans une inhumation traditionnelle, le corps est placé dans un cercueil, parfois traité avec des produits chimiques (embaumement, vernis). La décomposition peut prendre des dizaines d’années, et peut polluer les sols ou occuper un espace cloisonné durant des décennies.
Pour la crémation, rapide et moderne, elle reste énergivore (gaz, électricité) et émet du CO₂, sans compter la dispersion de métaux lourds contenus dans certaines prothèses ou amalgames dentaires.
Enfin, le compostage humain : rapide, naturel, non polluant, il permet de « boucler la boucle » en redonnant à la terre ce qu’elle nous a offert.
Pourquoi parle-t-on d’humusation ?
Le terme vient du mot humus, cette fine couche fertile du sol indispensable à la vie végétale. L’idée est simple : notre corps, composé d’éléments empruntés à la nature, peut redevenir une ressource vivante. Là où l’inhumation et la crémation « consomment » ou « enferment » la matière, l’humusation la restitue.
2. Les avantages et arguments écologiques du compostage humain.
Si le compostage humain commence à faire parler de lui ces dernières années, c’est qu’il représente une alternative radicalement différente aux modes funéraires traditionnels. Derrière l’aspect surprenant de l’idée se cachent des arguments écologiques puissants, mais aussi des avantages économiques et symboliques.
Un geste profondément écologique.
Zéro produit chimique : contrairement à l’embaumement (formol, vernis, colles), l’humusation repose uniquement sur des matières naturelles.
Réduction des émissions de CO₂ : la crémation émet environ 160 kg de CO₂ par corps incinéré, soit l’équivalent d’un aller-retour Bruxelles–Rome en avion.
Le compostage humain, lui, n’émet quasiment rien.
Préservation des sols et des nappes phréatiques : un cercueil verni ou un corps embaumé peut libérer des substances toxiques (métaux lourds, solvants) dans la terre. Avec l’humusation, le sol reçoit un humus sain et fertile.
Une solution face au manque d’espace.
Les grandes villes connaissent une saturation des cimetières. Créer de nouvelles parcelles funéraires implique d’artificialiser encore des sols. Le compostage humain, lui, ne demande pas de surface dédiée à long terme : au terme du processus, il restitue de l’espace tout en enrichissant la nature.
Boucler la boucle du vivant.
En acceptant de redevenir humus, nous nous inscrivons dans le cycle naturel de la vie. Nos corps deviennent une ressource pour la terre, les arbres et les générations futures. C’est une manière concrète de dire : « je rends à la nature ce qu’elle m’a donné ».
Pour certains, il s’agit même de l’ultime acte de générosité humaine : donner la vie après la mort en redevant humus.
Un coût potentiellement réduit.
Même si la filière est encore émergente, on estime que le compostage humain pourrait être moins onéreux que l’inhumation ou la crémation, qui nécessitent cercueils, monuments, concessions ou installations énergivores.
Une dimension symbolique forte
Au-delà des chiffres, le compostage humain est porteur d’un message : notre passage sur Terre peut laisser une trace positive. Là où une pierre tombale ou une urne occupent un espace limité, l’humusation offre un héritage vivant, qui nourrit littéralement l’avenir.
3. Où cela existe-t-il déjà ?
Le compostage humain n’est plus une simple utopie : plusieurs pays ont déjà franchi le pas, et d’autres débattent activement de sa légalisation.
· Aux États-Unis : les pionniers
En 2019, l’État de Washington a été le premier au monde à autoriser la recomposition humaine. Depuis, plusieurs entreprises comme Recompose proposent aux familles de transformer le corps de leur proche en humus fertile.
Le mouvement a gagné d’autres États : Colorado, Oregon, Vermont, Californie, New York, Nevada, et la liste continue de s’allonger. Les États-Unis sont aujourd’hui les leaders mondiaux de cette alternative funéraire.
· Aux Pays-Bas : l’innovation écologique
Les Pays-Bas expérimentent avec des solutions funéraires durables, comme les cercueils en mycélium (champignons), qui accélèrent la décomposition. Même si le compostage humain intégral n’est pas encore autorisé, le pays fait partie des plus avancés en matière d’innovations écologiques liées à la mort.
· En Belgique : un débat en suspens.
Chez nous, l’ASBL Fondation Métamorphose milite depuis 2015 pour l’humusation comme troisième voie funéraire, aux côtés de l’inhumation et de la crémation. Elle est soutenue par d’autres acteurs comme la coopérative Humusation (Esneux) ou l’ASBL Huma Terra (Rixensart).
La Région wallonne a d’ailleurs commandité une étude scientifique à l’UCLouvain. Résultat : la faisabilité écologique de l’humusation n’a pas encore été démontrée, certains risques (pollution aux nitrates, délai de décomposition trop long) demandant des recherches supplémentaires.
À Bruxelles, le ministre Bernard Clerfayt a confirmé que l’humusation n’est pas autorisée à ce jour : seules l’inhumation et la crémation sont légales.
En résumé, l’idée progresse dans le débat public, mais le cadre légal belge reste fermé pour l’instant.
· En Allemagne : une avancée législative.
En Allemagne, le concept existe sous le nom de Reerdigung (« ré-enterrage »). En 2022, le Land de Schleswig-Holstein a légalisé cette pratique, devenant le premier territoire européen à reconnaître le compostage humain.
D’autres Länder, comme Hambourg, envisagent de suivre, ce qui pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large dans les prochaines années. L’Allemagne s’impose ainsi comme un pays pionnier en Europe, à la croisée des traditions funéraires et des préoccupations écologiques modernes.
· En France et ailleurs en Europe.
En France, le sujet reste sensible. Les autorités invoquent des incertitudes sanitaires et culturelles. L’idée circule pourtant dans les médias et associations, preuve que la société commence doucement à se préparer au débat.
Dans d’autres pays européens, la discussion n’en est qu’à ses balbutiements, mais l’exemple allemand pourrait faire bouger les lignes.
4. Les résistances et les questions éthiques.
Si le compostage humain séduit par son aspect écologique et symbolique, il soulève aussi de fortes résistances. Entre tabous culturels, craintes sanitaires et objections religieuses, l’idée ne fait pas l’unanimité.
Le poids des traditions et des émotions.
La mort est entourée de rituels anciens, profondément ancrés dans nos cultures. Enterrer nos proches, leur offrir une tombe, ou conserver leurs cendres répond à un besoin de mémoire et de lien. Pour beaucoup, l’idée de transformer un corps humain en compost semble choquante, presque irrespectueuse.
La peur d’une « banalisation » du corps après la mort alimente ces réticences : comment honorer la mémoire d’un proche si celui-ci devient simplement de l’humus répandu au pied d’un arbre ?
Les objections religieuses.
Les grandes traditions religieuses ne se positionnent pas toutes de la même façon :
Le christianisme reste attaché à l’inhumation et à la crémation, pratiques symboliques de respect du corps. Certaines voix considèrent l’humusation comme une atteinte à la dignité du défunt.
Le judaïsme et l’islam, très codifiés dans leurs rites funéraires, privilégient l’enterrement rapide, sans artifices, dans la terre. Si certains pourraient voir une proximité avec l’humusation (retour à la terre), l’absence de rituel codifié reste un frein majeur.
Les traditions orientales (bouddhisme, hindouisme) sont davantage centrées sur la libération de l’âme, mais la crémation y reste la norme.
En résumé, la dimension spirituelle reste encore un obstacle à l’adoption généralisée.
Les enjeux sanitaires et scientifiques.
Les études belges, notamment celle menée par l’UCLouvain, ont pointé des questions non résolues :
- Comment garantir l’absence de pollution aux nitrates dans les sols ?
- Le délai de décomposition est-il compatible avec une gestion sûre et respectueuse ?
- Les micro-organismes éliminent-ils bien tous les agents pathogènes ?
Tant que ces questions ne trouvent pas de réponses claires, les autorités publiques hésitent à franchir le pas.
La peur d’une « écologisation » de la mort
Certains critiques voient dans le compostage humain une dérive de notre époque : une volonté de rendre la mort « utile », presque instrumentalisée au nom de l’écologie. Derrière l’argument généreux, nourrir la Terre après nous, certains perçoivent un risque : réduire le défunt à une ressource plutôt qu’à une personne à honorer.
Une question de temps et d’acceptabilité sociale
Comme pour la crémation, longtemps rejetée avant de devenir une pratique courante, l’humusation aura sans doute besoin de temps pour s’imposer. Ce qui paraît choquant et ridicule aujourd’hui pourrait devenir, dans quelques décennies, une évidence écologique et culturelle.
5. Idée farfelue ou ultime acte de générosité ?
Alors ? Le compostage humain est-il une lubie écologique ou véritable acte de transmission ?
Tout dépend du regard que nous choisissons de porter.
D’un côté, l’idée peut sembler choquante, voire provocatrice. Elle bouscule notre rapport à la mort, nos traditions, nos rituels. Imaginer qu’un corps devienne du compost, destiné à nourrir les sols, peut heurter une sensibilité encore très attachée à l’image sacrée de la dépouille.
De l’autre, c’est peut-être le geste le plus généreux que nous puissions faire après notre dernier souffle : rendre à la Terre ce qu’elle nous a donné, participer à la continuité du vivant, offrir à nos proches un héritage qui ne se mesure pas en majestueuses et coûteuses pierres tombales, mais en arbres, en forêt, en vie.
Les stoïciens nous rappelleraient sans doute que la mort n’est ni un drame ni une fin absolue, mais un retour à l’ordre naturel. Accepter que notre corps rejoigne le cycle du vivant, ce n’est pas s’amoindrir, c’est au contraire reconnaître notre juste place dans la nature et l’univers.
Finalement, est-ce si farfelu de vouloir que notre dernier acte soit de nourrir la vie ? Peut-être que le compostage humain est moins une rupture qu’une réconciliation : une manière de mourir comme nous avons vécu, conscients, responsables et généreux.
Conclusion :
En écrivant cet article, je me rends compte que l’idée du compostage humain me séduit de plus en plus. Imaginer que, même après ma mort, je puisse encore contribuer à la vie, nourrir la Terre et participer à un cycle plus grand que moi, c’est une perspective qui me paraît belle, juste et profondément apaisante. J’espère vivre suffisamment longtemps pour rendre ce service aux générations futures, aux enfants de demain qui fouleront le sol de cette planète et qui auront besoin d’une nature vivante et généreuse.
Et pour clôturer sur une note positive remplie d’humanité au milieu de ce sujet si particulier : plutôt que de finir enfermé dans une urne poussiéreuse ornée sur une cheminée, ou allongé dans une caisse close au milieu d’un cimetière lugubre à perpétuité, je préfère savoir que mon corps pourrait revenir un jour sous forme de sacs de terreau, utilisés pour faire pousser un arbre, quelques fleurs ou même des légumes dans le jardin familial ou chez des amis. Je trouve que c’est une contribution bien plus joyeuse, remplie de positivité et tournée vers le cycle de la vie.
Après tout, quel plus bel héritage peut-on transmettre que d’offrir encore une fois la vie, même après la mort ?
À très vite pour la suite.
Vous pouvez lire aussi : Comment le « Memento Mori » trouve-t-il encore sa place dans notre vie ? – Nos états d’Am’s