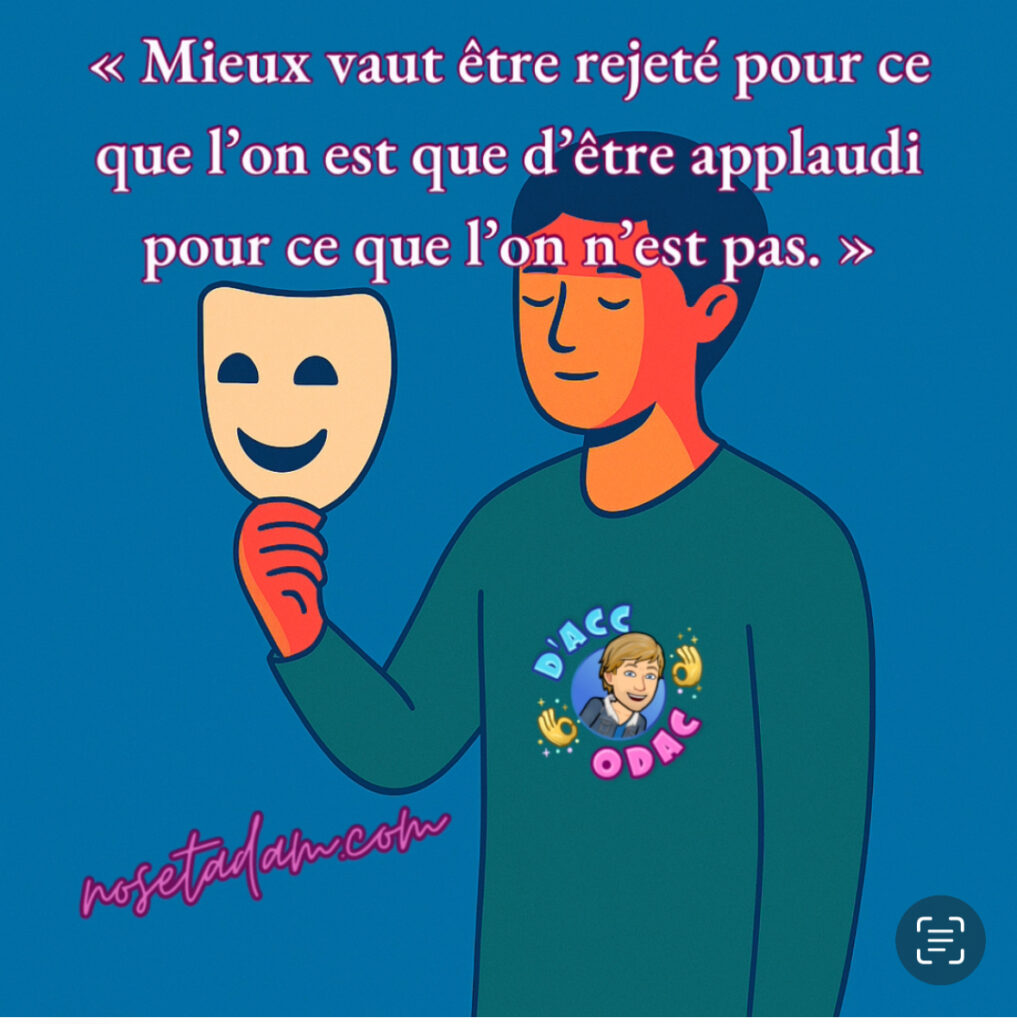
Il y a quelques semaines je vous parlais des droits assertifs fondamentaux, vous vous souvenez ? Ces droits que nous avons en tant qu’être humain, mais que souvent nous oublions ou l’on nous fait volontairement oublier pour abuser de nous et entretenir l’injustice. Si vous voulez vous remémorer les 5 premiers, je vous invite à relire la première partie de cet article : S’affirmer sans blesser, respecter sans se taire : développons notre assertivité. – Nos états d’Am’s
Pour les autres je vous rappelle que ces droits ont aussi des devoirs auxquels nous devons prêter attention pour ne pas basculer et garder l’égalité, la justice et la dignité de tous․
Les 5 droits fondamentaux qui font la suite
· J’ai le droit de dire « je ne sais pas ».
Ce droit nous permet de reconnaître nos limites, de faire preuve de lucidité et de maturité.
Le fait de pouvoir dire « je ne sais pas », c’est refuser la posture de sur contrôle ou d’omniscience. C’est ouvrir la voie à l’apprentissage, à la coopération, à la recherche commune. Ce droit est libérateur, il permet l’humilité sans honte.
Bien évidemment ce droit ne nous autorise pas à nous cacher derrière une ignorance volontaire ou confortable. Refuser de nous positionner par peur du conflit ou de l’engagement. Nous dérober à nos responsabilités sous prétexte que nous ne savons pas tout.
Bref, il est légitime de ne pas savoir, mais il est courageux de chercher à comprendre. L’ignorance assumée n’est pas l’ignorance entretenue. Il ne s’agit pas de se réfugier dans le doute, mais d’en faire un tremplin vers la clarté.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
Je peux dire « je ne sais pas » sans honte, car cela fait partie de la nature humaine. Mais je garde la volonté de progresser sur ce qui dépend de moi : ma capacité à apprendre, à interroger, à m’ouvrir.
· J’ai le droit de dire « je ne comprends pas ».
Quand nous osons dire « je ne comprends pas », en fait nous posons un acte d’honnêteté intellectuelle. Cela nous libère de la peur d’avoir l’air « bête » ou « lent ». Ce droit autorise la clarté, l’échange vrai, et la pédagogie bienveillante. Il ouvre la voie à la curiosité active, à l’écoute et à l’explicitation.
Cela ne nous autorise pas à nous réfugier dans l’incompréhension pour éviter un effort de concentration, une mise en question ou un dialogue difficile. Ou, à l’inverse, nous servir du « je ne comprends pas » comme moyen passif-agressif de remise en question de l’autre.
Dire « je ne comprends pas » nous engage à écouter, à demander, à reformuler, à chercher. L’incompréhension est un point de départ, pas une fin de non-recevoir. Il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir comprendre.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
J’ai le droit de ne pas comprendre, mais je garde le devoir de chercher la clarté. Ce qui dépend de moi, ce n’est pas tout comprendre, mais rester disponible à l’effort de compréhension.
· J’ai le droit de ne pas m’intéresser à certaines choses.
C’est un droit de sélection, d’attention et d’intégrité. Il nous autorise à ne pas tout suivre, à ne pas nous disperser, à préserver notre énergie mentale. Je peux dire : « Ce sujet ne me parle pas. Ce n’est pas pour moi. » Et nous pouvons le dire sans culpabilité ni justification interminable.
Bien évidemment nous ne pouvons pas avoir du mépris ce qui ne nous intéresse pas. Ignorer ce qui a de l’importance pour les autres par égocentrisme ou paresse intellectuelle. Se couper du monde et des réalités parce qu’elles dérangent.
Ce n’est pas parce qu’un sujet ne nous attire pas qu’il ne mérite pas d’être écouté un minimum. Refuser systématiquement de s’ouvrir à l’autre au nom du « ça ne m’intéresse pas » peut être un mur et certainement pas une frontière saine.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
Je choisis ce à quoi j’accorde mon attention. Mais je veille à ne pas cultiver l’indifférence ou l’ignorance orgueilleuse. Ce qui dépend de moi, c’est la qualité de ma présence au monde, même dans mes refus.
· J’ai le droit de dire « je m’en fiche ».
Ce droit est celui du désengagement lucide. Il autorise à ne pas nous laisser happer par tout, à ne pas être en alerte émotionnelle permanente. Il rappelle que nous pouvons lâcher prise sur certains débats, polémiques, pressions sociales ou attentes extérieurs sans nous justifier.
Ce droit ne nous autorise pas le mépris. L’indifférence blessante. Le cynisme. Dire « je m’en fiche » pour fuir la responsabilité ou se couper du lien. Utiliser ce droit comme carapace pour ne plus ressentir, ne plus s’engager, ne plus être touché.
Le vrai détachement n’est pas une fuite émotionnelle, c’est un choix conscient de là où l’on place son énergie. Il est stoïque par essence : je décide de ne pas m’agiter pour ce qui ne dépend pas de moi, mais cela ne veut pas dire que tout m’est égal.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
J’ai le droit de me désintéresser de ce qui ne me construit pas. Mais je refuse de sombrer dans l’indifférence froide ou hautaine. Ce qui dépend de moi, c’est la qualité de mon discernement, pas mon détachement absolu.
· J’ai le droit de réussir et d’être heureux.
Ce droit nous libère d’une croyance collective lourde : la culpabilité de réussir, comme si c’était indécent. Il permet de dire : « oui, je mérite la joie, la paix, l’accomplissement ». Ce droit nous invite à célébrer nos victoires sans peur de déranger ni besoin de s’excuser d’aller bien.
Ce droit ne nous autorise pas l’arrogance, la comparaison, l’écrasement. Réussir ne donne pas le droit de mépriser ceux qui en sont à d’autres étapes. Être heureux n’implique pas d’ignorer la souffrance des autres. On n’éclaire pas plus fort en éteignant les bougies voisines.
Ma réussite n’est juste que si elle est alignée avec mes valeurs, et si elle ne repose pas sur l’exploitation ou l’humiliation des autres. Mon bonheur est un bien précieux s’il est cultivé dans le respect du vivant autour de moi.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
Je choisis la joie et la croissance intérieure. Mais je reste humble, conscient que tout ne dépend pas de moi, et que la véritable réussite est celle qui me rend plus juste, plus libre, plus humain.
Des droits pour encore aller plus loin !
· J’ai le droit d’être le juge ultime de mes pensées, émotions et comportements, et d’en assumer les conséquences.
C’est un acte fondateur d’autonomie. Il affirme que nous sommes souverains sur notre monde intérieur. Nos pensées nous appartiennent. Nos émotions sont légitimes. Nos choix nous engagent. Ce droit nous autorise à ne plus chercher à tout prix la validation extérieure pour savoir si nous avons « raison » de penser ou de ressentir ce que nous ressentons.
Il me donne aussi la permission de dire « voici comment je vois les choses », même si cela dérange, même si ce n’est pas partagé.
Cela ne nous autorise pas à nous couper de toute écoute, de tout feedback, de tout dialogue. Ce n’est pas parce que nous sommes le juge ultime de nos pensées que nous sommes infaillibles. Ce n’est pas parce que nos émotions sont légitimes qu’elles sont toutes justes ou bien orientées.
Ce droit ne nous protège pas le déni, le dogmatisme ou l’égo surdimensionné. Il nous oblige, au contraire, à répondre de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements… pas à les imposer ou à les déverser.
Ce droit s’arrête là où je me dérobe à ses conséquences. Si je pense et j’agis librement, j’assume pleinement les effets que cela produit dans mes relations, dans mes engagements, dans mes résultats.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
Je suis responsable de mon monde intérieur. Ce qui dépend de moi, ce sont mes pensées, mes réactions, mes décisions. Je n’en fais pas un bouclier, mais une base solide pour agir en accord avec mes valeurs, dans le respect du réel et des autres.
· J’ai le droit d’être moi-même, sans chercher l’approbation des autres.
C’est le droit de la cohérence profonde, de l’authenticité. Il nous donne la liberté de ne pas jouer un rôle pour plaire, d’arrêter de me déformer pour rentrer dans le moule. Il nous libère de la dépendance au regard des autres. Il permet cette phrase simple et puissante : « Je suis assez tel que je suis ».
Il nous permet aussi de dire « non », d’afficher nos goûts, nos fragilités, nos élans, même s’ils détonnent. C’est le droit d’exister pleinement, pas seulement de paraître.
Ce droit ne permet pas d’ignorer les autres. De se croire supérieur. Revendiquer sa « vérité » comme une excuse pour blesser, choquer, ou rejeter l’altérité. « Être soi » n’est jamais une excuse pour manquer de respect ou d’intelligence relationnelle.
Ce droit ne doit pas non plus devenir une armure narcissique : « Je suis comme ça, prenez-moi ou partez. »
Ce droit s’arrête là où je nie l’impact de qui je suis sur ceux qui m’entourent. Être moi-même ne veut pas dire imposer mon moi, mais l’exprimer avec justesse et responsabilité. Je n’ai pas besoin de l’approbation des autres, mais je reste attentif à la manière dont je contribue au lien, ou au conflit.
Une reformulation stoïcienne et responsable :
Je ne cherche pas à plaire à tout prix. Je me construis dans l’authenticité. Ce qui dépend de moi, c’est la fidélité à mes valeurs. Mais je reste conscient que mon « moi » n’est pas un absolu, il évolue, se questionne, s’adapte avec conscience.
Conclusion :
Affirmer nos droits, c’est aussi accepter d’en assumer les conséquences
Une liberté qui engage : être responsable de ce que nous osons dire, faire ou refuser
Chaque droit assertif est une porte ouverte vers plus de liberté intérieure.
Mais une porte ouverte, ce n’est pas une échappatoire. C’est un passage.
Dire « j’ai le droit » ne nous dispense pas de réfléchir à l’impact de notre choix ni d’en assumer les répercussions.
J’ai le droit de dire « non »… mais suis-je prêt à accepter ce que ce « non » déclenche ?
J’ai le droit d’être le juge de mes émotions… mais est-ce que j’accueille vraiment ce que cela implique en termes de maturité relationnelle ?
J’ai le droit d’exister sans chercher à plaire… mais suis-je prêt à vivre parfois avec moins d’approbation, plus de solitude, ou davantage de critiques ?
La liberté assertive n’est jamais gratuite : elle nous met face à notre propre puissance d’agir… et à ses conséquences naturelles.
L’assertivité saine est une école d’humilité.
C’est ici que la sagesse des stoïciens résonne profondément. (voir l’article : Comment distinguer ce qui dépend de nous : le guide complet pour reprendre le contrôle de notre vie. – Nos états d’Am’s
Lorsque je m’affirme, je ne contrôle pas tout. Mais je me tiens droit dans ce qui dépend de moi. Et je lâche le reste. C’est ça, la noblesse de l’assertivité : elle ne cherche ni à plaire, ni à dominer, mais à être juste et alignée.
En tant que coachs, en tant qu’êtres humains qui accompagnent d’autres êtres humains, nous avons un rôle à jouer :
- Faire grandir la conscience de ce qui est un vrai droit… et de ce qui devient un mécanisme d’évitement.
- Inviter à l’autonomie, mais jamais au désengagement.
- Encourager l’affirmation, mais jamais l’arrogance.
L’affirmation de soi n’est pas un privilège. C’est une compétence éthique et relationnelle qui se cultive chaque jour.
Et si chaque droit devenait une responsabilité ?
Dans une société où l’on clame souvent ses droits à voix haute, il est salutaire de se poser une question simple, mais exigeante :
Que ferais-je si je considérais chacun de mes droits comme une responsabilité relationnelle ?
Nous ne parlons pas ici de devoirs imposés par l’extérieur, mais de devoirs intérieurs choisis, qui font grandir notre stature humaine.
L’affirmation de soi devient alors une éthique en action, où l’on cherche à rester fidèle à soi-même tout en honorant l’existence de l’autre.
Voici une grille de lecture possible — simple, mais puissante :
Ce que je ressens –>Ce que je veux exprimer–>Ce que je choisis d’assumer
J’ai de la colère –>Je veux poser une limite–>Je prends le risque d’un conflit, sans me fermer
J’ai besoin d’espace–>Je demande du temps pour moi–>Je clarifie sans fuir le lien
Je me sens jugé–>J’exprime mon ressenti–>Je ne cherche pas à avoir raison, mais à être entendu
Je suis en désaccord–>Je dis « non » –>J’assume de ne pas être approuvé, sans rejeter l’autre
Cette posture invite à une affirmation consciente, incarnée, ajustée. Elle replace nos droits dans un contexte relationnel et humain, bien loin du slogan défensif.
En tant qu’enseignants, coachs, parents, conjoints… nous avons une responsabilité de transmission.
- Transmettre le droit de dire « non », mais aussi la conscience des conséquences de ce « non ».
- Transmettre le droit de ressentir des émotions, mais aussi la capacité de les nommer, de les traverser sans qu’elles dirigent tout.
- Transmettre le droit d’avoir une opinion, mais aussi l’exigence d’écouter avant de s’exprimer.
Un adulte qui affirme calmement ses limites sans se justifier à l’excès, mais sans agressivité, enseigne la solidité tranquille.
Un adulte qui dit : « Là, j’ai besoin de temps, ce n’est pas contre toi, je prends soin de notre lien en me respectant aussi, » enseigne la maturité émotionnelle, la clarté intérieure et la paix.
Et si l’affirmation de soi devenait un art du lien, autant qu’un art de vivre ?
- S’affirmer, c’est aussi aimer l’autre avec maturité
S’affirmer n’est pas s’opposer. Ce n’est pas hausser le ton. Ce n’est pas se barricader derrière des principes.
- S’affirmer, c’est choisir. Choisir d’être pleinement soi, sans écraser l’autre.
C’est poser ses limites sans renier le lien. C’est dire oui avec cœur… et non avec respect.
Chaque droit assertif est une invitation à la clarté intérieure, à l’alignement, à la vérité nue. Mais cette vérité n’a de force que lorsqu’elle est offerte sans violence, sans justification inutile, sans fierté défensive.
Elle est puissante quand elle est habitée avec responsabilité, et orientée vers la relation.
Dire : « je suis responsable de ce que je ressens, de ce que je choisis, de ce que j’exprime »…
C’est déjà un acte d’amour.
Dans une époque bruyante où tout le monde parle de ses droits, choisir de les incarner avec calme, avec cohérence, avec conscience devient un acte révolutionnaire.
Et si nous faisions de cette révolution douce un art de vivre, une pédagogie, une culture ?
Et si affirmer nos droits devenait une façon de dire à l’autre :
« Tu comptes pour moi. Et je te respecte assez pour ne pas t’écraser. »
À très vite pour la suite