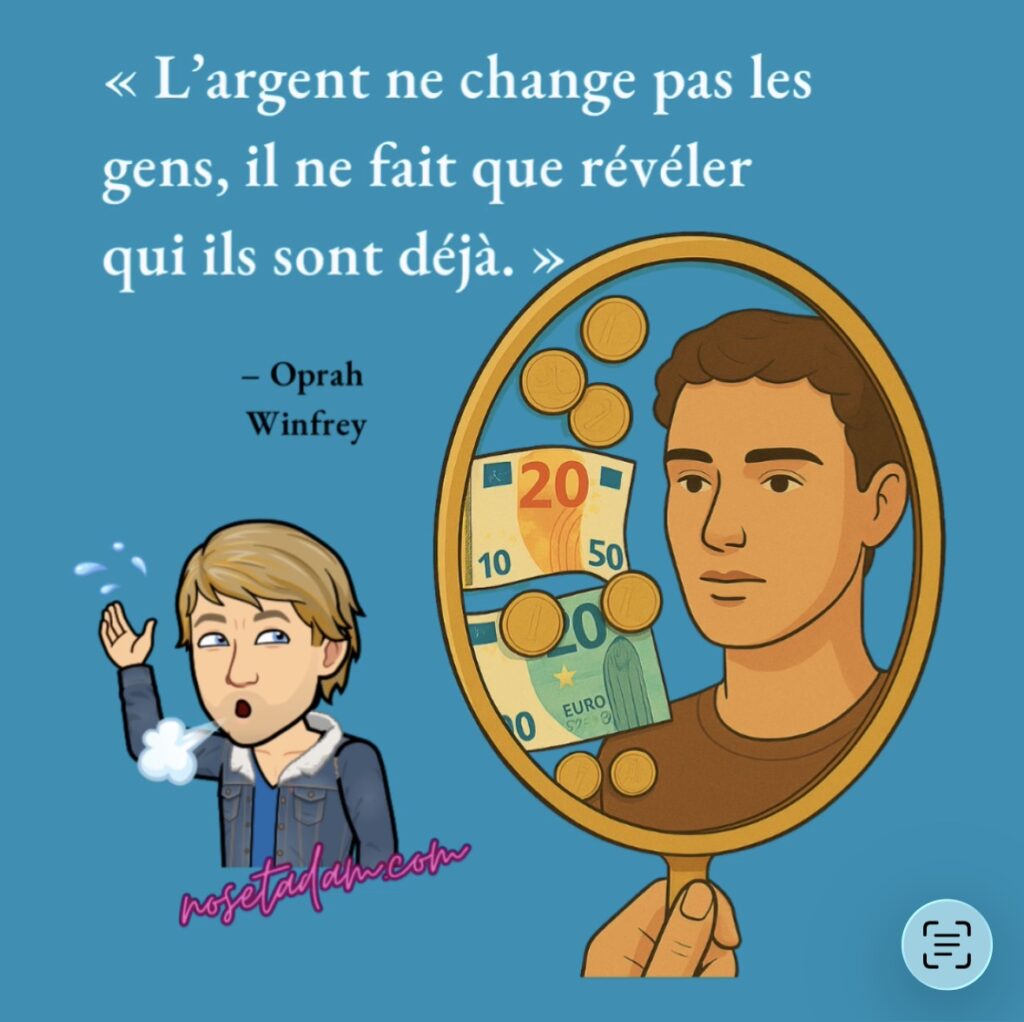
Chez nous, parler d’argent reste souvent un sujet tabou. Autour de la table familiale, on évoque sans problème la météo, la politique ou même la vie tumultueuse d’un(e) collègue… mais dès qu’il s’agit d’argent, le malaise s’installe. Les regards se détournent, les silences s’allongent, et la conversation bifurque rapidement vers un terrain plus confortable. Comme si l’argent, pourtant omniprésent dans nos vies, ne pouvait être abordé qu’en chuchotant, avec gêne.
Je me souviens d’une discussion avec quelqu’un de ma famille éloignée où la question d’un héritage avait été effleurée. En quelques secondes, l’ambiance est devenue pesante. Chacun avait son avis, mais personne n’osait vraiment poser les mots. Ce jour-là, j’ai réalisé à quel point notre rapport à l’argent était empreint de non-dits, de croyances héritées, et parfois même de honte.
Et pourtant, que nous le voulions ou non, l’argent fait partie intégrante de notre quotidien. Il influence nos choix, notre liberté, nos projets… et bien souvent nos angoisses. Mais si l’argent n’était pas le véritable problème ? Si le cœur du sujet résidait plutôt dans la manière dont nous percevons et vivons notre relation à l’argent ?
Dans cet article, nous allons questionner ce rapport complexe. Pourquoi l’argent génère-t-il autant de tensions ? Comment transformer notre vision pour qu’il redevienne un outil au service de nos valeurs et non une source de stress ? Ensemble, explorons une nouvelle façon d’aborder l’argent, plus consciente, plus apaisée et plus alignée avec ce que nous voulons vraiment dans nos vies.
1. L’argent comme énergie et symbole.
Si nous prenons un pas de recul, l’argent n’est qu’un moyen d’échange, un langage commun inventé par l’homme. Avant lui, nous vivions du troc : du blé contre une jarre, un service rendu contre un autre. Mais le troc avait ses limites : comment échanger un mouton contre une poignée de sel si les besoins ne coïncidaient pas ? C’est là que l’argent est né : comme une solution pratique, un outil neutre, destiné à faciliter les échanges.
Aujourd’hui encore, l’argent conserve cette fonction. En réalité, il n’a aucune valeur en soi. Un billet de 20 € n’est qu’un morceau de papier coloré. Sa puissance réside uniquement dans la valeur symbolique que nous lui attribuons collectivement. L’argent est devenu une énergie de circulation : il permet de transformer une idée en projet, un besoin en satisfaction, un rêve en réalité concrète.
Mais voilà : derrière cette neutralité se cache tout un monde de représentations. Chacun de nous a grandi avec des croyances transmises par sa famille, son environnement et sa culture. En Belgique, par exemple, nous avons souvent appris à être prudents, voire méfiants, avec l’argent. « Ne parle jamais de ce que tu gagnes ! », « Les assureurs et les banquiers, tous des voleurs ! « Économise pour les jours difficiles. » « Méfie-toi des riches » « Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, fais de la politique tu gagneras de l’or en barre à ne rien faire ». Ces phrases, répétées sans qu’on s’en rende compte, façonnent notre vision.
Résultat : l’argent n’est plus seulement un outil. Il devient un symbole chargé de sens.
Pour certains, il représente la sécurité, la liberté.
Pour d’autres, il est sale, synonyme forcément de voleur, de profiteur.
Pour d’autres encore, il représente la réussite, le pouvoir ou parfois même… la culpabilité.
Ce glissement est fondamental : nous ne traitons plus l’argent pour ce qu’il est (un moyen), mais pour ce qu’il symbolise dans notre imaginaire. Et ce symbole influence nos choix, nos comportements et même notre relation aux autres.
Alors, si nous voulons changer notre rapport à l’argent, la première étape est de désamorcer ce pouvoir symbolique. De revenir à l’essentiel : voir l’argent pour ce qu’il est, ni bon, ni mauvais, mais un outil au service de notre vie.
2. Les croyances qui nous emprisonnent.
Derrière notre rapport à l’argent se cachent souvent des croyances profondes, héritées de notre enfance, de notre famille et de la culture dans laquelle nous baignons. Ces croyances sont comme des lunettes invisibles : elles filtrent notre manière de voir le monde sans que nous nous en rendions compte.
En Belgique comme ailleurs en Europe, certaines phrases résonnent encore dans nos mémoires :
« L’argent ne tombe pas du ciel. » ou « l’argent ne pousse pas sur les arbres »
« Il faut travailler dur pour gagner sa croute. »
« Les patrons sont des salauds qui exploitent les pauvres comme nous. »
« L’argent ne fait pas le bonheur et moi je suis bien heureux comme ça ! »
Ces formules, répétées à table ou entendues à l’école, s’inscrivent dans notre inconscient.
Elles deviennent des règles implicites qui guident nos décisions financières… souvent à notre insu.
Il existe deux grandes peurs liées à l’argent :
La peur d’en manquer.
Elle pousse à l’épargne excessive, à se priver même lorsque c’est inutile, ou à vivre dans l’angoisse constante des factures. Ici, l’argent devient synonyme de sécurité, mais aussi de peur permanente.
La peur d’en avoir trop.
Moins visible, mais tout aussi puissante : elle se manifeste par la culpabilité à gagner plus que son entourage, la peur d’être jugé, ou la crainte que l’on pense qu’on « a vendu son âme au diable » si l’on devient riche. D’être catalogué « t’es vraiment comme eux ! » Résultat : certains s’autosabotent inconsciemment, en repoussant les opportunités ou en refusant la réussite.
Quand les croyances dictent nos choix
Celui qui pense que « l’argent est sale » n’osera pas demander une augmentation, même s’il la mérite.
Celui qui croit que « l’argent fait le bonheur » cherchera à combler ses manques affectifs en accumulant toujours plus… sans jamais être satisfait.
Celui qui associe « argent » au « pouvoir » risque de l’utiliser comme un moyen de domination au lieu d’un outil de liberté.
Ces croyances sont des prisons invisibles. Elles limitent notre liberté intérieure et nous éloignent de la vérité :
l’argent, en soi, ne dit rien de nous. C’est notre manière de l’utiliser qui révèle notre valeur.
Changer notre rapport à l’argent, c’est donc commencer par mettre en lumière ces croyances. Les questionner. Les déconstruire. Et choisir consciemment celles qui nous aident à avancer, plutôt que de subir celles qui nous enferment.
3. Vers une approche plus saine : l’argent comme outil.
Une fois que nous avons mis en lumière nos croyances vient le moment d’un véritable changement de perspective. Trop souvent, nous plaçons l’argent sur un piédestal : il devient un objectif, un juge, un poids. Or, rappelons-le : l’argent n’est qu’un outil. Rien de plus, rien de moins.
Replacer l’argent à sa juste place.
Les stoïciens nous enseignent que la richesse fait partie des « indifférents préférés » : elle peut faciliter la vie, mais elle ne définit pas notre valeur en tant qu’être humain. Être riche ou pauvre ne dit rien de notre vertu, de notre sagesse ou de notre capacité à aimer. Autrement dit : posséder de l’argent peut être pratique, mais ce n’est jamais une fin en soi.
L’argent comme un serviteur, pas comme un maître.
Quand nous cessons de courir après l’argent pour lui-même, nous découvrons une liberté nouvelle. L’argent devient un serviteur au service de nos projets, de notre épanouissement, de notre contribution au monde.
Il peut acheter du temps (en déléguant certaines tâches).
Il peut ouvrir des opportunités (formations, voyages, découvertes).
Il peut amplifier notre impact (soutenir des causes, investir dans des projets qui comptent).
La valeur derrière l’argent
Au fond, ce qui compte n’est pas le billet en lui-même, mais ce qu’il représente.
Pour certains, un compte bien garni signifie sécurité.
Pour d’autres, dépenser sans compter veut dire liberté.
Et pour beaucoup, l’argent est le reflet de leur valeur personnelle.
Mais cette équation est piégeuse : elle nous enferme dans une quête sans fin.
Et si nous changions la question ?
Demandons-nous non pas « combien j’ai », mais « qu’est-ce que je fais de ce que j’ai ? »
Ne nous exprimons plus en « combien je gagne », mais « quelle valeur je crée » ?
En posant ce regard, nous redonnons à l’argent sa juste place : un outil au service de la vie que nous voulons construire, pas une finalité qui nous détourne de l’essentiel.
4. Les pratiques pour changer notre rapport à l’argent.
Changer notre vision de l’argent n’est pas qu’une idée théorique : c’est une pratique quotidienne. Nous avons grandi avec des habitudes, des croyances et des réflexes qui demandent à être réexaminés. Voici quelques pratiques simples mais puissantes pour transformer notre rapport à l’argent.
a. Identifier nos croyances limitantes.
Prenons un moment pour écrire les phrases que nous avons entendues sur l’argent dans notre enfance :
« Il faut travailler dur pour y arriver. »,
« L’argent ne pousse pas sur les arbres. »
« Il faut être égoïste pour devenir riches. »
Ensuite, demandons-nous : est-ce que cette croyance me sert encore aujourd’hui ? Est-elle vraie ? Ou simplement héritée ? Cette introspection permet déjà d’ouvrir une brèche dans le conditionnement inconscient.
Voir l’article : Comment apprendre à aimer ce qui est ? — Nos états d’Am’s
b. Pratiquer la gratitude et l’abondance.
Nous avons souvent le réflexe de voir ce qui manque, rarement de reconnaître ce qui est déjà là. Chaque soir, notons trois choses que l’argent nous a permis de vivre dans la journée : un repas partagé, un trajet en train, une tasse de café… Ce rituel développe un sentiment d’abondance plutôt que de manque.
c. Investir en soi.
La meilleure utilisation de l’argent n’est pas dans l’accumulation, mais dans la croissance. Acheter un livre, suivre une formation, prendre soin de sa santé : voilà des investissements qui portent leurs fruits bien au-delà des chiffres d’un compte bancaire. Ici encore, les stoïciens seraient d’accord : ce que personne ne peut nous retirer, c’est la qualité de notre esprit et de notre caractère.
d. Mettre en place une gestion consciente.
Au lieu de subir nos dépenses, reprenons les commandes.
Faire un budget aligné avec nos valeurs, ce n’est pas se priver, mais choisir en conscience.
Par exemple : décider qu’une partie de nos revenus sera consacrée à l’apprentissage, une autre à nos loisirs, une autre encore à la contribution (don, projets solidaires).
L’argent devient alors un reflet de ce qui compte vraiment pour nous.
e. Relier argent et sens.
Chaque fois que nous dépensons ou que nous recevons de l’argent, posons-nous une question simple : est-ce que cette transaction est alignée avec la vie que je veux construire ?
Si oui, elle nous rapproche de nos valeurs.
Sinon, elle nous éloigne et mérite d’être réévaluée.
Changer notre rapport à l’argent, ce n’est pas seulement accumuler plus ou dépenser moins. C’est surtout apprendre à l’utiliser avec conscience, en cohérence avec ce que nous voulons être et transmettre.
5. De l’argent à la valeur : la transformation intérieure.
À force de chercher à accumuler de l’argent, nous oublions souvent l’essentiel : ce n’est pas le chiffre inscrit sur notre compte en banque qui détermine notre richesse intérieure, mais ce que nous faisons de cet argent et ce qu’il représente pour nous.
Redéfinissons la richesse.
La véritable richesse ne se mesure pas uniquement en euros. Elle se mesure aussi en temps, en liberté, en qualité de relations, en capacité à contribuer. Une personne peut avoir un salaire moyen mais jouir d’une vie riche en expériences, en temps libre et en sens.
Inversement, quelqu’un peut gagner beaucoup mais se sentir prisonnier de ses obligations, de son image ou de ses dettes.
Passons de l’accumulation à la contribution.
L’argent devient source de transformation lorsqu’il cesse d’être une fin en soi.
Ce n’est pas « combien je possède » qui compte, mais « quel impact je crée avec ce que je possède ».
Un euro dépensé pour un projet qui me fait grandir a plus de valeur qu’un billet oublié dans un tiroir.
Un investissement dans une cause qui me tient à cœur me procure une satisfaction durable que n’apportera jamais un objet de consommation éphémère.
En d’autres termes : l’argent est puissant quand il est mis au service d’une valeur plus grande que lui.
Quelques exemples concrets.
Certains choisissent de réduire leur temps de travail pour passer plus de moments avec leurs enfants : ils troquent de l’argent contre du temps de qualité.
D’autres, comme moi, décident d’investir une partie de leurs revenus dans une formation ou un projet créatif : ils convertissent l’argent en croissance personnelle.
D’autres encore s’engagent à soutenir une association, une ONG, ou un ami en difficulté : l’argent devient vecteur de solidarité.
Ces choix montrent que l’argent n’est pas seulement un outil de consommation, mais aussi un levier de transformation intérieure. Il nous aide à aligner nos actions avec nos valeurs profondes.
Changeons la question.
Plutôt que de demander : « Combien ai-je gagné ce mois-ci ? », demandons-nous :
« Quelle valeur ai-je créée pour moi et pour les autres ? »
« En quoi mon utilisation de l’argent reflète-t-elle la vie que je veux construire ? »
En changeant la question, nous changeons le jeu. L’argent cesse d’être une fin en soi pour devenir un moyen d’expression de ce que nous sommes vraiment.
Conclusion : Choisir la liberté.
Et si, finalement, le vrai changement n’était pas dans l’argent lui-même, mais dans notre regard ? L’argent n’a jamais été qu’un outil, un moyen d’échange, une énergie qui circule. Ce sont nos croyances, nos peurs et nos projections qui lui donnent un poids démesuré.
En Europe, plus qu’ailleurs, nous avons appris à éviter le sujet, à en parler du bout des lèvres, comme si l’argent était trop gênant, trop dangereux ou trop intime. Pourtant, plus nous le fuyons, plus il gouverne nos vies en silence.
Changer notre rapport à l’argent, c’est choisir de reprendre le pouvoir. C’est décider que l’argent ne sera plus un maître tyrannique, mais un serviteur au service de ce qui compte vraiment : notre liberté, notre temps, nos relations, notre contribution au monde.
Ce n’est pas une révolution extérieure, mais une transformation intérieure. Elle commence par la lucidité : identifier nos croyances, questionner nos habitudes, remettre l’argent à sa place. Elle se poursuit par des choix concrets : investir en nous, gérer nos finances en conscience, donner du sens à chaque euro qui circule entre nos mains.
Alors, posons-nous cette question simple mais puissante :
Mon rapport à l’argent me rapproche-t-il de la vie que je veux construire, ou m’en éloigne-t-il ?
À nous de choisir. Et si nous décidions, ensemble, de faire de l’argent un allié plutôt qu’un fardeau, un outil de liberté plutôt qu’une prison ?
Parce qu’au fond, l’argent ne dit rien de ce que nous valons. Mais ce que nous en faisons dit tout de ce que nous choisissons de devenir.
À très vite pour la suite.
vous pouvez lire aussi : https://nosetadam.com/la-liberte-financiere-un-reve-reserve-aux-riches/